Projets européens
Le CEN Occitanie peut être monteur, coordinateur et/ou partenaires de projets européens et transfrontaliers. Il apporte sa connaissance, son expertise et son expérience pour la préservation de la biodiversité de la région Occitanie. Nous vous présentons ci-dessous l’ensemble des projets sur lequel il intervient.
Le LIFE Biodiv'Paysanne
Le LIFE Terra Musiva :
Terre de Mosaïque
Ce projet d’une durée de 6 ans (2022/2027) vise à préserver les espaces naturels, la faune et la flore locale de la région, parmi les plus riches de France en termes de biodiversité, menacés par l’artificialisation des milieux, l’intensification de l’agriculture ou la déprise agricole qui laisse les sites à l’abandon.
Ce projet d’une durée de 5 ans (2021/2026), vise à protéger les habitats et les espèces d’intérêt communautaire des garrigues gardoises.
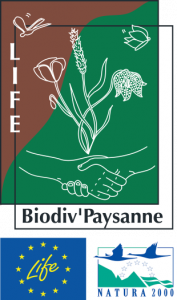
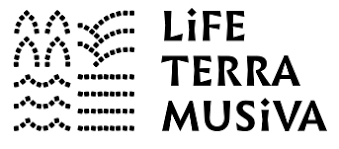
Les projets agroécologiques
Au-delà du LIFE, le CEN Occitanie porte ou est impliqué dans plusieurs projets agroécologiques dans les territoires de la région. Certains de ces projets sont présentés ici :
SUDOE -
FLoRE
L’objectif du projet vise le développement de solutions fondées sur la nature basées sur l’utilisation d’herbacées sauvages d’origine locale pour la restauration écologique d’espaces mis à mal par les activités humaines.

SUDOE -
Fleurs locales
L’objectif du projet est d’étudier, de définir et d’établir des solutions basées sur la nature à travers l’utilisation de semences autochtones efficaces et rentables dans des contextes tels que les vignobles, les agrosystèmes et les milieux naturels méditerranéen
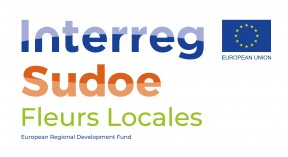
Infrastructures agroécologiques : RESIFARMS, un projet européen Erasmus+
L’objectif du projet est de promouvoir les services écosystémiques et les enjeux de conservation des espaces semi-naturels et des infrastructures agroécologiques au sein des exploitations agricoles Erasmus+

TerrAES -
Territoires engagées pour la Transition AgroÉcologique Sociale et Solidaire
L’objectif du projet est un accompagnement des collectivités publiques du Gard et de l’Hérault dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets agroécologiques.

Les réseaux d'acteurs
Le CEN Occitanie est membre de plusieurs réseaux d’acteurs afin de contribuer collectivement à la connaissance et/ou à des actions de préservation
Pôle-relais Lagunes Méditerranéennes
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes est un consortium coordonné par la Tour du Valat en PACA, en partenariat avec le CEN Occitanie et l’Office de l’Environnement de la Corse pour une meilleure reconnaissance des milieux lagunaires de la Méditerranée et une gestion durable de ces espaces qui représentent 130 000 hectares sur l’ensemble des trois régions. Les pôles-relais bénéficient d’un label national de reconnaissance de leur action et, en 2021, leur charte a été renouvelée pour cinq ans.
Projets en lien avec les forêts
Le CEN Occitanie participe à l’amélioration et la valorisation des connaissances sur les vieilles forêts d’Occitanie
Vieilles forêts
InSylBioS
L’objectif du programme Vieilles forêts était d’identifier les Réservoirs de Biodiversité Forestière à partir d’une approche descriptive de la structure et l’historique des forêts (présence de dryades naturelles, ancienneté forestière, densité de gros bois vivants et morts, diversité spécifique, diversité d’habitats et de micro-habitats) sur un territoire où l’information n’est pas disponible.
« Mieux comprendre et INtégrer dans les pratiques SYLvicoles le rôle de la BIOdiversité des Sols dans le fonctionnement des forêts du sud du Massif Central », tel est l’objectif fixé par le projet InSylBioS lancé en 2020.
Stratégie régionale relative aux espèces exotiques envahissantes (EEE) Faune d'Occitanie
Vers une meilleure gestion des espèces exotiques envahissantes Faune d’Occitanie
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie (CEN Occitanie) anime la stratégie et met en œuvre le plan régional d’actions sur les EEE Faune d’Occitanie. Le projet est soutenu par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL Occitanie) et la Région Occitanie.

Travail sur les zones humides
Préservation de la fonctionnalité d'un réseau de zones humides
Ce programme a pour objectif d’initier des actions de préservation des zones humides situées en tête de trois bassins versants de la partie orientale des Pyrénées.

Il vise trois objectifs principaux :
• Améliorer les connaissances sur la fonctionnalité de ce réseau de zones humides et sur le cortège d’espèces associées afin de mener une gestion adaptée ;
• Mettre en place des actions de gestion permettant l’amélioration de la connectivité entre les populations de Cuivré de la Bistorte ;
• Sensibiliser les usagers du territoire à la gestion des zones humides et à la trame turquoise tant sur le plan de la biodiversité que sur les usages associés.
En ce sens, à l’automne 2021 et 2022, des travaux de réouverture ont permis de rétablir des corridors écologiques dans le secteur du col des Ares entre Puyvalador et Quérigut et au sud du lac de Matemale. Pour limiter l’impact des travaux sur les zones humides, le débardage s’est fait par traction animale.
SAGNE 48 : un service d'aide à la gestion de zones humides en Lozère
SAGNE 48 est un service d’aide à la gestion des zones humides qui a pour objectif de développer une stratégie de gestion durable et cohérente des zones humides à travers l’animation d’un réseau de gestionnaires et de sites.

Qui peut bénéficier de ce réseau ? Qu’est-ce qu’il offre à ses adhérents ? Comment adhérer ?
L’adhésion offre plusieurs avantages :
- Des diagnostics approfondis et adaptés à chaque site ;
- La définition concertée de préconisations de gestion, permettant de conserver ou améliorer les qualités fonctionnelles et écologiques des sites ;
- Un appui technique et un suivi des sites réguliers ;
- Un accompagnement pour la définition et la programmation d’aménagements et de travaux spécifiques adaptés à la gestion durable des zones humides (y compris montage de dossiers de demande de financement si besoin) : dispositifs d’abreuvement du bétail adaptés, aménagements éco-pastoraux, passages sur cours d’eau, coupe sélective d’arbres, débardage animal, valorisation…


